Les Orionides en 2022 |
Des cieux bien sombres pour le retour des Orionides |
Entre le 02 Octobre et le 07 Novembre, la Terre croise pour la deuxième fois de l'année, les poussières éjectées par une comète connue de tous. En effet, tout comme les eta-Aquarides que les observateurs des tropiques et de l'hémisphère Sud peuvent admirer en Mai, l'essaim des Orionides a pour origine la célèbre comète de Halley (1P/Halley).
Cette année, le maximum d'activité de cet essaim intéressant est prévu pour le 22 Octobre vers 00h05 UTC, lors du passage de la Terre à la longitude héliocentrique de 208°.
En 2003, la Lune en phase de Premier Quartier (PQ le 22 à 03h29 UTC) se couche au moment où Orion se lève. L'observation du maximum d'activité devrait se dérouler dans d'excellentes conditions.
Le radiant des Orionides, situé près de l'équateur céleste, atteint une hauteur raisonnable aux environs de minuit local dans n'importe quel hémisphère, un peu avant dans le nord, aussi une grande partie du globe peut profiter du spectacle sous des cieux bien sombres.
Le taux horaire moyen (ZHR) pour ce nouveau retour des Orionides est estimé à environ 20.
Mais l'essaim peut créer la surprise... chaque retour de 2006 à 2009 a produit des ZHR étonnamment forts d'environ 40 à 70 sur deux ou trois dates consécutives. Une analyse de l'IMO antérieure de l'essaim, utilisant des données de 1984 à 2001, a révélé que les pics de ZHR et les paramètres r (index de population) variaient quelque peu d'une année à l'autre, le ZHR moyen le plus élevé allant de ~14 à 31 pendant l'intervalle examiné. En outre, une périodicité présumée de 12 ans des retours plus forts constatée au début du XXe siècle n'est pas détectable à partir des données visuelles, mais semble se produire dans les données radar CMOR (Canadian Meteor Orbit Radar) depuis 2002 (Egal et al., 2020). Aussi la question d'une périodicité dans le taux est encore ouverte.
Une activité plus élevée due au cycle suspecté a été mentionnée pour la période 2020-2022 dans les calendriers précédents. Les ZHRs maximaux moyens pour les Orionides au cours des années 2012-2020 étaient compris entre 20 et 30. Les Orionides fournissent souvent plusieurs maxima inférieurs, aidant l'activité à rester parfois à peu près constante pendant plusieurs nuits consécutives centrées sur le pic principal. En 1993 et 1998, un sous-maximum à peu près aussi fort que le pic normal a été détecté les 17 et 18 Octobre en Europe, par exemple.
Aussi, il est préférable de réserver plusieurs soirées à l'observation des météores, car on l'a vu dans le passé, une bonne surprise peut toujours se produire compte-tenu de la variabilité d'activité de l'essaim !
Au moment de l'horaire prévu pour le maximum d'activité de l'essaim, le 22 Octobre vers 17h55 UTC, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Océan Indien, l'Asie, seront plongés dans la nuit.
L'avancée de la nuit, le 21 Octobre 2022 à 17h55 UTC
Pour la France et les pays limitrophes, le radiant se lève vers 21h00 UTC et grimpe rapidement pour atteindre une hauteur de plus de 55° au-dessus de l'horizon vers 04h00 UTC lors de son passage au méridien. Les nuits entourant le moment du maximum peuvent aussi donner lieu à l'apparition de quelques beaux spécimens, notamment lorsque le radiant sera au plus haut en seconde partie de nuit ou en toute fin de nuit.
Avec une vitesse d'environ 66 km/s, les météores sont très rapides, et laissent la plupart du temps une traînée persistante visible plusieurs secondes après leur passage.
La meilleure zone d'observation semble se situer à 40-60° de part et d'autre du radiant.
Emplacement (en rouge) du radiant de l'essaim météoritique des Orionides (ORI) le 22 Octobre à 00h00 UTC (indiqué pour Paris - France). ORI = Orionides; LMI = Leo Minorides; EGE = epsilon-Geminides; STA = Taurides Sud; NTA = Taurides Nord
Avec un radiant proche de l'équateur céleste, l'essaim est également observable sous les tropiques et dans une grande partie de l'hémisphère sud.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
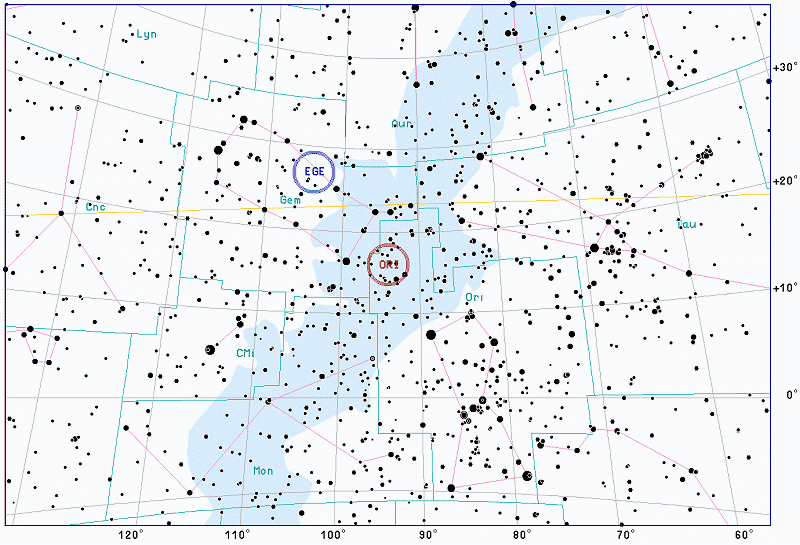
Le jour du maximum d'activité, le 21 Octobre, le radiant des Orionides
(RA=95° [6 h 20 m], DEC=+16°), est situé au-dessus de Bételgeuse.
Les Orionides, un essaim complexe |
L'essaim météoritique des Orionides tire son nom du fait que les étoiles filantes semblent provenir d'un même point du ciel (le radiant) situé dans la constellation d'Orion.
Le radiant, situé dans la constellation d'Orion début Octobre, se déplace progressivement vers les Gémeaux.
La proximité du radiant des Orionides avec celui des epsilon-Géminides est l'une des sources fréquentes d'erreurs d'indentification de l'origine des météores observés. En effet, l'essaim des epsilon-Géminides est également actif entre les 14 et 27 Octobre avec un maximum centré sur le 18. De surcroît la vitesse des météores est sensiblement la même (66 km/s pour les Orionides et 70 km/s pour les epsilon-Géminides). Bien que les Orionides semblent présenter une teinte légèrement plus jaune qui peut conduire à les distinguer des epsilon-Géminides, seul le recours au dessin, à la photographie ou à l'enregistrement vidéo vous permettra de les différencier à coup sûr en établissant précisément l'origine du radiant.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet essaim a été observé pour la première fois en 1839 par E.C. Herrick, mais les premières observations précises ont été réalisées par Alexander Stewart Herschel en 1864.
Pendant longtemps le radiant de cet essaim fut l'objet de controverses et débats. William F. Denning, soutenu par A. Frace Cook et J.P.M. Prentice, estimait que le radiant était immobile, tandis que Charles P. Olivier estimait que celui-ci dérivait lentement. Olivier démontra en 1922 une dérive du radiant en ascension droite, mais n'apporta pas la preuve d'un évident mouvement en déclinaison. En 1928, la campagne d'observation dirigée par Ronald A. McIntosh, confirma de nouveau les résultats obtenus par Olivier.
Les premières estimations de l'activité de l'essaim datent de 1892 avec un taux horaire de 15. Durant les 30 années suivantes, les observateurs prennent conscience que l'activité des Orionides est variable. Ainsi en 1900, le taux horaire est seulement de 7, tandis qu'il atteint 35 en 1922. Malgré le retour de la comète de Halley en 1910, peu d'observations furent réalisées entre 1903 et 1922 pour mettre en évidence un sursaut de l'essaim lié au retour de la comète-parent. Il est toutefois intéressant de noter que les taux horaires de l'essaim semblent se stabiliser depuis cette période. Ainsi entre 1930 et 1953, le taux est voisin de 15 sans jamais excéder 20 météores par heure. Entre 1960 et 1974, le taux horaire est proche de 24 avec des pointes entre 30 et 40 en quatre occasions. Entre 1975 et 1985, le taux moyen horaire dépasse les 18 avec un maximum de 24. En 2001, des observateurs japonais ont relevé un taux horaire moyen proche de 40 pour la nuit du maximum.
A partir des données de l'IMO recueillies entre 1984 et 2001, Audrius Dubietis (Vilnius University, Lithuania) a mené début 2003 une analyse sur l'essaim, permettant ainsi d'affiner légèrement le ZHR du pic et l'indice de population r. Ces deux paramètres ont également fait preuve d'une certaine variabilité d'une année sur l'autre, notamment en ce qui concerne le ZHR maximum qui s'étale de 15 à 30 ces vingt dernières années. De plus, une périodicité de 12 ans, qui avait été suspectée plus tôt au XXème siècle, semble avoir été partiellement confirmée. Selon cette analyse, des taux les plus importants seraient attendus pour 2008-2010, et par la suite vers 2014-2016. L'analyse d'Andrius Dubietis montre également une corrélation entre les profils d'activité à long terme pour les Orionides et l'essaim des eta-Aquarides, également associé à la comète 1P/Halley.
La relation entre l'essaim des Orionides et la comète de Halley a été indirectement établie par Charles P. Olivier en 1911 qui mentionna la similarité entre l'orbite des Orionides et celle des Eta-Aquarides de Mai, que l'on savait déjà reliée à la comète de Halley depuis 1868. Toutefois, le lien entre la célèbre comète et l'essaim des Orionides n'était toujours pas considéré comme définitif, comme l'avait fait remarquer J.G. Porter en 1948. Porter considérait en effet que la séparation de 0.15 UA entre l'orbite de la comète et l'orbite de la Terre était suffisante pour dissuader d'établir une relation entre l'essaim et la comète.
En 1983, B.A. McIntosh (Herzberg Institute of Astrophysics, Ottawa, Canada) et Hajduk (Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Czechoslovakia) publient un nouveau modèle d'un essaim météoritique produit par la comète de Halley, en s'appuyant sur les travaux réalisés en 1981 par Donald K. Yeomans et Tao Kiang et relatif à l'orbite de la comète de Halley depuis l'an -1404. Mc Intosh et Hajduk parviennent à la conclusion que des météoroïdes existent en orbite aux endroits où se trouvait la comète quelques révolutions auparavant. De multiples perturbations ont eu pour effet de regrouper l'essaim dans des ceintures à orbites stables, contenant de nombreux débris. Ces ceintures sont considérées comme l'explication des variations d'activité des Orionides et des Eta-Aquarides d'une année sur l'autre.
Une autre caractéristique insolite des Orionides concerne son activité qui reste imprévisible.
L'essaim des Orionides peut présenter plusieurs maxima autres que le maximum principal (21 Octobre), avec une activité quasi constante pendant plusieurs nuits consécutives aux alentours du pic d'activité. Tel fut le cas en 1993 et 1998 où l'on enregistra dans la nuit du 17 au 18 Octobre un maximum secondaire aussi important que le pic normal du 21 Octobre, ou encore en 1981 où 10 météores par heure furent enregistrés entre les 18 et 21 Octobre (maximum le 21), tandis que dans la matinée du 23, l'activité passa à près de 20 par heure. Cet essaim peut donc réserver de belles surprises pour peu que l'on observe les quelques jours précédents la date du maximum ainsi que les jours suivants celle-ci.
Une tentative d'explication à ce comportement fut proposée en 1982 : deux maxima ayant lieu à deux moments différents. Une autre hypothèse supposait que le moment du maximum serait très étalé dans le temps et sujet à des variabilités. La meilleure explication fut apportée par le Tchécoslovaque A. Hadjuk (Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Czechoslovakia) en 1970 : la variabilité peut s'expliquer par la présence de structures filamentaires de météorides le long de l'orbite. Cette théorie fut confirmée en 1975 par des observations radar.
Une nouvelle caractéristique de l'essaim est qu'il possède deux radiants actifs, signalés en 1939 par J.P.M. Prentice, et confirmés par des observations conduites en Tchécoslovaquie, notamment par V. Znojil (Public Observatory, Brno), dans les années 60. L'analyse des données recueillies par Znojil révélèrent deux radiants distincts : les Orionides nord, produisant des météores de faible luminosité, et les Orionides sud émettant des météores plus brillants.
Par le passé, plusieurs radiants secondaires ont également été rapportés. Cependant les enregistrements vidéos récents suggèrent que le radiant est bien moins complexe qu'on le supposait.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'observation des essaims de météores peut s'apprécier sans matériel spécifique, l'observation à l'oeil nu étant le moyen le plus simple de profiter du spectacle. Toutefois, pour ménager vos vertèbres cervicales, il est préférable de s'allonger à même le sol, d'utiliser une chaise longue ou un siège réglable, ce qui vous permettra ainsi de scruter le ciel dans de meilleures conditions.
Un carnet vous sera également indispensable si vous souhaitez noter vos observations, surtout si vous avez la chance de voir passer un bolide. Enfin, une paire de jumelles sera utile si vous souhaitez observer les traînées lumineuses laissées par les bolides.
Une manière efficace d'observer visuellement les météores est la méthode du comptage, où l'observateur note les météores vus sur un papier ou enregistre le comptage sur un magnétophone en donnant la magnitude estimée du météore et l'appartenance à l'essaim observé. Cette méthode très simple à mettre en oeuvre permet d'établir par la suite un rapport d'observation.
exemple : August 8, 2007 Lieu d'observation (Ville, Pays) Longitude 000 degrees 00' 00" East, Latitude 00 degrees 00' 00" North. UT Period Field Teff F LM PER KCG SPO 7:44-8:47 60N 1.01 1.0 6.51 3 2 9 Note : La première colonne (UT Period) fait référence à la période d'observation, en Temps Universel. Le seconde colonne (Field) est le secteur du ciel où le champ visuel a été concentré. La troisième colonne (Teff) représente le temps effectif d'observation, c'est-à-dire en tenant compte des pauses ou du temps non passé à observer le ciel. La colonne (LM) est la magnitude limite moyenne à l'oeil nu, déterminée à partir d'au moins trois champs d'étoiles. Les colonnes suivantes indiquent le nombre de météores pour chaque essaim observé.
Total Meteors: 14 Magnitude Distributions: Shower -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 PER 1 1 1 KCG 1 3 SPO 1 1 2 4
Note : La magnitude -4 est comparable à l'éclat
de la planète Vénus, la magnitude -1 à la brillante
étoile Sirius, La majorité des étoiles visibles
à l'oeil nu sont de magnitude +2 à +3. Les plus faibles
étoiles que l'on peut voir à l'oeil nu sous un ciel
bien sombre sont de magnitude +6 à +7. La table contient les magnitudes de tous les météores observés, et la moyenne (dernière colonne) pour l'essaim.
L'oeil nu peut détecter des météores jusqu'à approximativement la magnitude +7 dans d'excellentes conditions à proximité du centre du champ visuel. Les techniques vidéo permettent la détection des météores à la magnitude +8, et les observations de météores par radar ou avec un télescope peuvent permettre la détection de météores faibles, jusqu'à la magnitude +11. Si la détection au moyen de la photographie peut difficilement concurrencer ces deux dernières méthodes de recherche de météores qui réclament d'avantage de technique, elle est en revanche moins onéreuse et en conséquence plus facilement abordable pour l'astronome amateur.
L'observation vidéo a quelques avantages par rapport à d'autres méthodes d'observation, et peut être combinée avec l'observation visuelle, photographique ou télescopique. En utilisant un système vidéo vous avez la puissance d'un observateur visuel ou même télescopique, mais une exactitude beaucoup plus élevée. Vous pouvez déterminer tous les paramètres importants des météores tels que l'heure, le temps d'observation, la position, l'éclat, et la vitesse.
Les météores peuvent également être détectés par radio. En pénétrant dans l'atmosphère terrestre, le météore crée derrière lui une ionisation locale, qui à la propriété de réfléchir les ondes électromagnétiques du spectre radio. Le moyen le plus simple "d'entendre" cet écho radio est de rechercher une fréquence de la bande FM (88-108MHz) où habituellement aucune radio ne diffuse. Le passage d'un météore engendrera la diffusion d'un signal radio sporadique là où il n'y avait qu'un bruit de fond. Cependant, la majorité des échos sont très difficilement discernables car très rapides et presque noyés dans le bruit de fond. Des techniques un peu plus sophistiquées peuvent être mises en oeuvre au moyen d'une radio, d'un ordinateur, et d'un logiciel de détection, par toute personne intéressée par cette technique simple de radioastronomie.
Vous avez observé, lors d'une soirée d'observation ou tout à fait par hasard, un impressionnant météore d'une magnitude inférieure à -3, autrement dit un "bolide"... alors n'hésitez pas à remplir le formulaire (en français) : http://fireballs.imo.net/members/imo/report_intro
Rien de plus facile ! Un appareil photo (type reflex) muni d'un objectif grand-angle ouvert à f/d 2 réglé sur l'infini, un bon trépied stable et un déclencheur manuel pour éviter les vibrations. De bons résultats peuvent également être obtenus avec un 50mm ouvert au maximum.
Choisissez de préférence un film rapide de 400 ou 800 ISO.
Quelle que soit la position du radiant, visez de préférence au zénith, vous aurez ainsi plus de chance de capturer le passage d'étoiles filantes.
N'hésitez pas à faire des poses d'environ 3 à 5 minutes avec une pellicule 400 ISO, surtout si vous êtes loin de toutes lumières parasites. Evitez cependant d'avoir la Lune dans le champ de l'objectif, ou à proximité en raison des reflets secondaires. Si vous souhaitez privilégier la prise de vue des traînées persistantes, utilisez de préférence une pellicule de 800 ISO, avec un temps de pose compris entre 30 et 60 secondes.
|