Les Léonides en 2023 |
Comme chaque année à pareille époque, la Terre croise sur sa trajectoire les nuages plus ou moins importants de particules de poussières laissées par la comète 55P/Tempel-Tuttle lors de ses approches au Soleil. Le pic traditionnel d'activité de l'essaim météoritique des Léonides, actif du 06 au 30 Novembre, devrait se produire en 2023 le 18 Novembre vers 05h25 UTC (Longitude héliocentrique de 235,27°).
Après les tempêtes observées entre 1999 et 2002 qui étaient directement liées au passage au périhélie en 1998 de la comète 55P/Tempel-Tuttle, le niveau d'activité des Léonides n'a fait que décroître progressivement. Cependant, malgré cette baisse sensible d'activité au fil des ans, l'intérêt pour cet essaim est resté intact et les Léonides figurent parmi les essaims les plus beaux et les plus fascinants de l'année.
Selon les prévisionniste de l'IMO, l'activité pour le pic nodal risque d'être "normale", avec probablement un ZHR proche de 10.
Le plus récent passage au périhélie de la comète parent s'est produit il y a maintenant plus de 20 ans, et entre-temps la comète a effectué son passage à l'aphélie. La connaissance des mécanismes d'éjection des poussières et de l'évolution des traînées de particules a permis de prévoir et de vérifier une activité variable sur de nombreuses années jusqu'à récemment. Le pic d'activité de l'essaim en 2023 se produit le 18 Novembre peu après la Nouvelle Lune.
Selon le prévisionniste russe Mikhail Maslov, aucune rencontre significative avec des traînées n'a été trouvée pour 2023, l'activité des Léonides devrait être principalement formée par une composante de fond. A 22h00 UTC le 17 Novembre, l'activité s'élèvera à 15 météores sur l'échelle ZHR. De plus, à 12 heures UTC le 21 Novembre, une légère augmentation de la traînée de 1767 est possible. L'activité s'élèvera à 10-15 météores sur l'échelle ZHR avec une luminosité bien supérieure au niveau moyen.
Les conditions d'observation en 2023 sont excellentes puisque le pic d'activité de l'essaim des Léonides se produit dans un ciel sans Lune, le croissant lunaire se couchant peu après la fin du crépuscule.
L'emplacement du radiant des Léonides, situé à quelques degrés de l'écliptique, a pour conséquence que l'essaim est également observable dans une grande partie de l'hémisphère sud.
Emplacement du radiant de l'essaim météoritique des Léonides (LEO) le 17 Novembre à 00h00 UTC (indiqué pour Paris - France). D'autres essaims peuvent également produire des météores cette nuit-là : Orionides de Novembre (NOO), Taurides Nord (NTA) et Taurides Sud (STA), alpha-Monocerotides (AMO).
Toutes les méthodes d'observations peuvent être utilisées. La détection par vidéo a indiqué qu'une faible activité des Léonides pourrait être détectée pendant un intervalle beaucoup plus long que ce qui avait été précédemment suspecté, et bien que ceci reste à confirmer visuellement, les dates d'activité pour l'essaim ont été élargies en conséquence.
D'autres maximums possibles ne sont pas exclus, et les observateurs devraient être en alerte aussi souvent que les conditions le permettent pendant toute la période d'activité de l'essaim, au cas où quelque chose d'inattendue se produirait.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'essaim météoritique des Léonides tire son nom du fait que les étoiles filantes semblent provenir d'un même point du ciel (le radiant) situé dans la constellation du Lion.
|
||||||||||||||||||||||
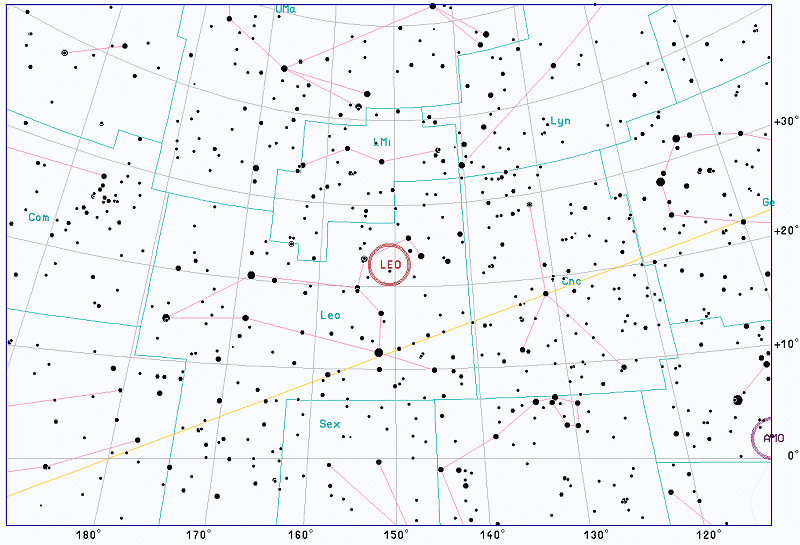
Emplacement du radiant de l'essaim météoritique des Léonides (RA=153° [10 h 12 m], DEC=+22°) le jour du maximum
Les Léonides sont issues des débris laissés sur sa trajectoire par la comète 55P/Tempel-Tuttle, d'une période de 33 ans et 3 mois environ.
L'inclinaison de l'orbite de 55P/Tempel-Tuttle par rapport au plan de l'écliptique est de 162.5°. Le déplacement de la comète est donc rétrograde, et de ce fait, les particules rencontrent presque de front l'atmosphère terrestre, produisant des météores extrêmement rapides (71 km/s), généralement courtes. De nombreux météores sont très lumineux et ont un éclat proche de la magnitude 0.
|
Les recherches de textes anciens effectuées par Edward C. Herrick en 1841, par Hubert Anson Newton en 1864, puis en 1958 par Susumu Imoto et Ichiro Hasegawa, pour les textes anciens chinois, japonais et coréens, et plus récemment par Donald K. Yeomans et Gary W. Kronk, ont mis en évidence de nombreuses traces de pluies météoritiques, attribuées aux Léonides, dont la plus ancienne remonte à l'an 901.
Mais l'intérêt pour cet essaim, produisant de spectaculaires pluies de météores, a surtout débuté peu après la grande tempête de 1833.
L'une des plus célèbres tempêtes de météores s'est produite dans la nuit du 12 au 13 Novembre 1833, lorsque la Terre croisa l'essaim des Léonides. Ce jour-là, des nombreux observateurs de la côte Est des Etats-Unis et de la région des Chutes du Niagara, virent surgir des centaines de météores par minute, soit environ 50.000 à 200.000 météores par heure, semblant provenir de la région de la constellation du Lion (Leo). Le nom de Léonides fut donné à cet essaim.
Déjà, en Novembre 1799, un phénomène similaire avait été observé par le naturaliste allemand Alexander von Humboldt (1769-1859) en compagnie du botaniste français Aimé Bonpland (1773-1858), au large des côtes du Vénézuela.
Le médecin allemand Heinrich Olbers (1758-1840), découvreur des astéroïdes Vesta et Pallas, fut le premier à oser prédire un retour de l'essaim pour 1867 en se basant sur l'étude de documents historiques plus anciens. Ainsi en Novembre 1866, au cours de la nuit du du 13 au 14, une nouvelle pluie importante de météores s'abattit sur notre planète, confirmant ainsi la périodicité de l'essaim. Il était maintenant évident que l'essaim revenait tous les 33 ans, mais restait à en trouver l'origine !
Le voile fut levé par la découverte d'une comète de magnitude 6, le 19 Décembre 1865 par Ernst Wilhelm Leberecht Tempel (1811-1889), mais également par Horace Parnell Tuttle le 6 Janvier 1866. La comète fraîchement découverte, et aujourd'hui dénommée 55P/Temple-Tuttle, fut visible pendant plusieurs semaines. Le calcul des éléments orbitaux montrait une grande similitude avec ceux de l'essaim, et confirmait la paternité de cette comète pour l'essaim météoritique des Léonides.
L'influence perturbatrice de Saturne et de Jupiter, en agissant sur la partie la plus dense de l'essaim, fit que l'averse suivante, prévue en 1899 n'eut pas lieu. Toutefois, l'essaim se manifesta de nouveau en 1901 mais le nombre de météores observés ne fut pas exceptionnel. Le retour suivant, en 1932 fut encore plus décevant.
En revanche, en 1966, en raison de nouvelles perturbations, l'on vit quelques 150.000 météores par heure à l'ouest des Etats-Unis et au Mexique. Ce retour de pluie météoritique coïncide avec la redécouverte de 55P/Tempel-Tuttle qui s'était fait plutôt discrète depuis sa découverte 100 ans auparavant.
|
|
|||||||
Avec le nouveau passage au périhélie de la comète 55P/Tempel-Tuttle le 27 Février 1998, un nouveau sursaut de l'essaim était attendu. Toutefois, la tempête annoncée n'a pas eu lieu à la date prévue, mais une vingtaine d'heures auparavant. De quoi obliger les prévisionnistes à revoir leur copie pour les années suivantes.
L'analyse des nombreuses données en provenance des observateurs du monde entier, a permis d'affiner les prévisions, et de mieux comprendre la dynamique de cet essaim. L'année 1999 fut marquée par la parfaite prévision de l'astronome anglais David Asher et de son collègue australien Rob McNaught.
Reproduisant correctement les observations passées, le modèle proposé a donné également de très bons résultats pour 2000 et 2001, même si les prévisions du finlandais Esko Lyytinen et de son équipe semblent plus précises quant aux horaires. De son côté, les estimations du nombre de météores faites pour 2001 par l'astronome Peter Jennisken semblent plus conformes à la réalité.
En 2002, le modèle développé par Jérémie Vaubaillon et François Colas de l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul d'Ephémérides (IMCCE) a été celui qui a donné les prévisions les plus réalistes, tant pour les horaires que pour la quantité de météores observés.
Les prochaines années seront très certainement déterminantes pour l'élaboration d'une théorie complète et plus élaborée, décrivant précisément le comportement de cet essaim atypique mais fascinant.
Les années de Tempête
- En 1998, l'analyse des données recueillies par l'IMO a montré que le taux horaire n'a pas dépassé 180 dans la nuit du 17 au 18 Novembre. Mais le maximum a bien eu lieu une vingtaine d'heures auparavant, le 16 Novembre vers 22h30 UT avec une culmination le 17 vers 01h40 (ZHR=340) au-dessus de l'Océan Atlantique.
- En 1999, la Terre traversa lors du premier pic, les débris laissés par la comète en 1899 et 1932, puis, lors du second pic, a frôlé un essaim de particules abandonné par l'astre en 1866. Les données recueilles par l'IMO ont permis d'évaluer le taux horaire d'étoiles filantes à près de 3.700 au moment du maximum le 18 Novembre à 02h02 UT.
- En 2000, la Terre passa lors du premier pic, près des débris laissés par la comète en 1932 , puis lors des second et troisième pics, près de ceux abandonnés en 1733 et 1866. L'analyse des données recueillies par l'IMO a mis en évidence trois pics : le premier le 17 Novembre à 08h07 UT (ZHR = 130 +/-20), le second le 18 à 03h24 UT (ZHR = 290 +/-20) et le troisième à 07h12 UT (ZHR = 480 +/-20).
|
||||||||
- En 2001, la Terre frôla lors du premier pic, les débris laissés par la comète en 1767, puis, lors des second et troisième pics, traversa ceux que l'astre a abandonnés dans sa course en 1699 et 1866. Le dépouillement des premières données recueillies par l'IMO a fait apparaître un premier pic le 18 Novembre entre 10h30 et 10h40 UT (taux horaire moyen estimé de 1.400 météores), ainsi qu'un second pic vers 18h20 UT (taux horaire moyen estimé à 2.800 étoiles filantes).
|
|
|||||||
- En 2002, la Terre traversa lors du premier pic, les débris laissés par la comète en 1767, puis, lors du second pic, passa au beau milieu de la veine de 1866. Le dépouillement des premières données recueillies par l'IMO a fait apparaître un premier pic au-dessus de l'Europe le 19 Novembre à 04h10 UT (taux horaire moyen estimé de 2.350 météores), ainsi qu'un second pic à 10h50 UT au-dessus de l'Amérique du Nord (taux horaire moyen estimé à 2660 étoiles filantes).
|
|
|||||||
Une activité décroissante
- En 2003, La Terre traversa les débris laissés par la comète 55P/Temple-Tuttle en 1499 et 1533, et ce à dix jours d'intervalle. Le dépouillement des premières données recueillies par l'IMO montre que l'activité en 2003 est restée faible, avec un taux proche de 60, lorsque la Terre a croisé le 19 Novembre les débris laissés en 1533. Une légère activité a été signalée le 13 Novembre, avec un taux voisin de 20, correspondant à la rencontre, annoncée quelques mois auparavant par les prévisionnistes, des débris datant de 1499.
|
|
|||||||
- En 2004 : Les simulations informatiques donnaient des prévisions pour le 8 Novembre vers 23h30 UTC (veine de 1001), 17 novembre vers 09h20 UTC (veine de 1932), 19 Novembre vers 06h40 UTC (veine de 1333), 19 Novembre vers 21h40 UTC (veine de 1733), 21 Novembre vers 08h20 UTC (veine de 1135), et 21 Novembre vers 10h00 UTC (veine de 1167). La rencontre avec les poussières laissées devait montrer un ZHR de peut-être 65 par heure pendant plusieurs dizaines de secondes. Les données recueillies ne montrent pas de pics coïncidant avec les temps de rencontres prévues. Aucun clair pic d'activité n'a été détecté pour les 08 et 19 Novembre.
- En 2005 : Si le retour de l'essaim météoritique des Léonides en 2004 a été quelque peu décevant par la quantité de météores visibles, le retour en 2005 des célèbres "étoiles filantes" l'a été encore plus. La présence de la Pleine Lune dans le ciel a considérablement gêné l'observation de la faible activité de l'essaim (ZHR de 20) pour ce nouveau retour annuel.
L'analyse des données obtenues par 92 observateurs dans 25 pays, recueillies par l'IMO, montre que le maximum d'activité s'est produit le 19 vers 04:50 UTC (ZHR maximum de 64 d'après l'analyse de 2594 météores observés, et ZHR maxi de 78 à 04h49 UTC d'après l'analyse portant sur 1422 météores observés).
Le finlandais Esko Lyytinen placait le moment du maximum un peu plus tôt, à 22h36 UTC. Selon le japonais Isao Sato, des météores pourraient provenir d'un radiant situé à 154° en Ascension droite et +21,4° de Déclinaison, à une vitesse géocentrique de 70,9 km/sec. Selon lui, la rencontre avec le flot de particules s'annonçait semblable à celle de l'année dernière et le taux horaire devrait être moins élevé, probablement un ZHR aux alentours de 30-80 par heure. Le sursaut d'activité devait durer seulement 1 à 2 heures. Peter Jenniskens prévoyait plutôt un pic centré sur un peu plus d'une demi-heure.
Le prévisionniste russe Mikhail Maslov annonçait un maximum plus faible que la moyenne pour 2007, avec un maximum d'activité le 17 Novembre à 20h43 UTC avec un ZHR de 15-20. La rencontre avec le flot de 1932 suivra, le 18 novembre à 23h05 UTC. Son intensité sera un peu plus élevé, avec un ZHR de 60-65 météores.
Il fallait donc plutôt s'attendre pour 2007 à une activité "normale" avec un nombre de météores visibles voisin de la centaine (ZHR de 100+, selon l'IMO), comme pour les années éloignées du passage au périhélie de la comète productrice des particules, suivi d'une activité moins importante (ZHR d'environ 30) une vingtaine d'heures plus tard.... sauf bonne surprise imprévue.
L'analyse des données obtenues par 48 observateurs dans 15 pays, recueillies par l'IMO, montre que le maximum d'activité s'est produit le 18 vers 23:52 UTC (ZHR maximum de 35 d'après l'analyse de 1079 météores observés. Les ZHRs de 30 ont également été observés le 18 à 22:07 UTC et le 19 à 02:24 UTC.
|
||||||||
- En 2008 : Mikhail Maslov prévoyait un maximum traditionnel un peu plus élevé que le niveau moyen, coïncidant avec un sursaut d'activité dû à la rencontre de la Terre avec le flot de particules abandonnées en 1466, et estimait le taux horaire moyen (ZHR) à environ 130 vers 00h22 UTC le 17 Novembre 2008, avec des météores plus brillants que la moyenne.
Jérémie Vaubaillon prévoyait des rencontres avec deux potentiels flots de particules :
- un première rencontre le 17 Novembre à 01h32 UTC (LS= 234.94943°) avec les poussières abandonnées en 1466. Le modèle initial de prévision laissait entendre que la rencontre pourrait donner lieu à un taux horaire moyen très élevé, mais s'agissant de particules anciennes, un prudent ZHR d'environ 100 était de mise.
- la seconde rencontre le 18 Novembre à 21h28 UTC (LS= 236.80280°) lors du croisement de la Terre avec les débris laissés en 1932. Ce flot de particules avait donné lieu les années précédentes à des prévisions d'activité de l'essaim qui n'ont pas tenu leurs promesses, aussi Jérémie Vaubaillon préfèrait rester plutôt vague quant au ZHR (de peut-être ~10-100 ?).
La campagne d'observation montre que le maximum est survenu environ 1 heure plus tard que prévu, signifiant que le flot de particules abandonnées en 1466 n'était pas situé à l'endroit prévu. Le ZHR était proche de ce qui était pronostiqué (ZHR d'environ 100 lors du maximum).
L'analyse des données, recueillies par l'IMO, obtenues par 29 observateurs dans 15 pays et portant sur 672 météores observés montre que le maximum d'activité s'est produit le 17 vers 02h03 UTC (ZHR maximum de 99). A 02h29 UTC, le ZHR était encore de 82. Les Léonides étaient dans l'ensemble assez brillantes, sans pour autant être exceptionnellement brillantes.
|
Pic traditionnal Crédit : Jérémie Vaubaillon/IMCCE
Veine de 1466 Crédit : Jérémie Vaubaillon/IMCCE Veine de 1932 Crédit : Jérémie Vaubaillon/IMCCE
|
|||||||
- en 2009 : Le moment du maximum d'activité de l'essaim des Léonides avait lieu en période de Nouvelle Lune (NL le 16). Les conditions d'observation étaient, par conséquent, idéales.
Les travaux des spécialistes finlandais Esko Lyytinen et Marku Nissinen suggèraient que le flot de particules libérées en 1466 pouvait produire des taux généralement élevés, avec des ZHRs au-dessus de 20, de 06h30 UTC le 17 novembre 2009 jusqu'au lendemain 00h30 UTC, et probablement au-dessus de 40 le 17 Novembre vers 16h00-23h00 UTC. Ce niveau d'activité serait probablement combiné avec celui du flot de 1533, faisant monter le taux horaire moyen jusqu'à peut-être 120 à certains moments entre 21h00-22h00 UTC le 17 Novembre. Le ZHR maximum était estimé à 60 pour chacune des deux traînées de particules.
Le spécialiste russe Mikhail Maslov prévoyait un maximum traditionnel très fort en 2009, d'un ZHR de 20-25. En dehors de ce pic traditionnel, un certain nombre de petits sursauts d'activité était attendu. Le premier d'entre eux était un petit pic produit par la rencontre du flot de particules de 1767. Cumulé avec le fond d'activité, le ZHR était estimé atteindre 15-20 le 16 Novembre vers 13h30 UTC, avec des météores d'un éclat plutôt faible. Le second serait causé par la rencontre avec le flot de particules de 1567, également de petite intensité. La traînée passant à une assez grande distance de la Terre, l'augmentation d'activité prévue était très modeste, jusqu'à 25-30 météores avec le fond d'activité. Le moment de la rencontre au plus près avec ce flot était prévu pour le 17 Novembre vers 06h20 UTC, mais l'activité de fond croissante pouvant décaler le moment du pic jusqu'à 1 à 2 heures plus tard. L'activité indiquait un palier avec un ZHR de 25-30 à partir d'environ 06h00 UTC le 17 Novembre. L'éclat des météores de la traînée de 1567 pouvait être un peu plus élévé que la moyenne.
Maslov prévoyait que le maximum traditionnel des Léonides pouvait être un peu masqué par le troisième pic d'activité produit par les particules relâchées en 1466 et 1533. La Terre avait de multiples rencontres avec les fragments de ces traînées, qui ensemble devaient produire un large et intense sursaut d'activité avec un ZHR de 170-180. Le moment du maximum était prévu pour le 17 Novembre à 21h35 UTC, mais pendant deux ou trois heures autour de ce moment un certain nombre de petis pics était possible. Enfin, un quatrième sursaut, également petit, était prévu. Le 18 Novembre vers 19h24 UTC, l'activité des Léonides pouvait grimper à 20-25 météores, d'éclat moyen, lors de la rencontre avec la traînée de 1201. Vu l'âge de la traînée, la prévision de ce pic n'était pas aussi fiable que pour les trois pics précédents.
|
||||||||
Jérémie Vaubaillon (IMCCE), en collaboration avec P. Jenniskens (SETI), J. Wanatabe et M. Sato (NAOJ), avait estimé que les Léonides ne produiraient pas de tempête en 2009 mais que nous serions certainement témoin d'un regain d'activité. Les toutes récentes prévisions mentionnaient la présence de deux courants distincts dans le voisinage de la Terre le 17 Novembre 2009, à savoir les traînées de particules laissées en 1466 et en 1533, chacune causant une forte activité à peu près au même moment, avec un ZHR total de 200/h. Le pic d'activité, avec un ZHR possible de 115/h, déclenché par la traversée du flot de 1466 que la Terre avait déjà croisé en 2008, était prévu vers 21h43 UTC (LS = 235.54461°) ou un peu plus tard, le maximum en 2008 ayant également eu lieu avec un peu de retard sur l'horaire prévu. La traversée du flot de particules de 1533, bien moins connu, pouvait donner lieu vers 21h50 UTC (LS = 235.54952°) à un surcroît d'activité avec un taux proche de 80/h. La rencontre de la Terre avec ces deux courants principaux pouvait même être précédée par la traversée d'une veine de particules abandonnées par la comète 55P/Tempel-Tuttle en 1567, donnant lieu à un pic d'activité vers 07h27 UTC (LS = 234.94546°) le 17 Novembre, d'un ZHR estimé à 25 environ. La traversée d'un flot de poussières abandonnées en 1102 pouvait aussi donner lieu à un autre pic d'activité le 18 Novembre vers 03h29 UTC. La position de cette veine très ancienne était cependant très incertaine, mais pouvait produire une activité notable (ZHR de 10-50 ?).
|
Crédit : Jérémie Vaubaillon/IMCCE
|
|||||||
Les prévisions de David Asher (Armagh Observatory) et ses collègues confirmaient celles de Mikhail Maslov, Jérémie Vaubaillon, Esko Lyytinen...
David Asher (Armagh Observatory) et ses collègues prévoyaient plus de 100 météores par heure vus sous des conditions idéales au cours de la fin de soirée du 17 et le début de la matinée du 18 Novembre.
Selon les prévisions de Mikiya Sato, la Terre croisait trois courants principaux le 17 Novembre avec un maximum d'activité vers 21h30 UTC : le courant de 1466 produisant une activité maximum vers 21h12 UTC (ZHR de 60), la rencontre avec le courant de 1533 connaissant son maximum vers 21h30 UTC (ZHR de 160), précédant de quelques minutes un nouveau sursaut d'activité produit par une seconde rencontre avec le courant de 1466 vers 21h52 UTC (ZHR de 30). Le taux horaire total maximum au zénith (ZHR total maximum) était estimé à environ 250 selon le prévisionniste japonais.
L'analyse des données, recueillies par l'IMO, obtenues par 121 observateurs dans 26 pays et portant sur 4419 météores observés en 1222 intervalles montre que le maximum d'activité s'est produit le 17 Novembre vers 20h27 UTC. Le ZHR maximum était de 79.
- en 2010 : Les spécialistes ne prévoyaient aucun sursaut spécial d'activité. Comme prévu, l'essaim a proposé une activité plutôt "ordinaire". L'analyse des données, recueillies par l'IM0, obtenues par 43 observateurs répartis dans 19 pays et portant sur 514 Léonides en 206 intervalles de temps montre que le maximum d'activité s'est produit le 18 Novembre vers 04h40 UTC. Le ZHR maximum était de 32±5, en supposant un index de population de r = 2.0.
- en 2011 : L'analyse des données, recueillies par l'IMO, obtenues par 30 observateurs dans 15 pays et portant sur 258 météores observés en 125 intervalles montre que le maximum d'activité s'est produit le 18 Novembre vers 03h29 UTC. Le ZHR maximum a été estimé à 22 (±3), en supposant un index de population de r = 2.5.
- en 2012 : L'analyse des données, recueillies par l'IMO, obtenues par 33 observateurs dans 14 pays et portant sur 366 météores observés en 142 intervalles montre que le maximum d'activité s'est produit le 20 Novembre vers 06h11 UTC. Le ZHR maximum a été estimé à 47 (±11), en supposant un index de population de r = 2.5.
- en 2013 : L'analyse des données, établie par l'IMO et portant sur 28 léonides observées en 4 intervalles, indique un ZHR de 21, en supposant un index de population de r = 2.0.
- en 2014 : L'analyse des données recueillies par l'IMO, obtenues par 19 observateurs et portant sur 163 météores observés en 12 intervalles de temps, montre un ZHR de 32, en supposant un index de population de r = 2.0.
- en 2015 : L'analyse des données recueillies par l'IMO, obtenues par 28 observateurs et portant sur 302 météores observés en 21 intervalles de temps, montre un ZHR de 16, en supposant un index de population de r = 2.0.
- en 2016 : L'analyse des données recueillies par l'IMO, obtenues par 6 observateurs et portant sur 12 météores observés en 5 intervalles de temps, indique un ZHR de 9, en supposant un index de population de r = 2.0.
- en 2017 : L'analyse des données recueillies par l'IMO, obtenues par 25 observateurs et portant sur 294 météores observés en 18 intervalles de temps, montre un ZHR de 22, en supposant un index de population de r = 2.0. - en 2018 : L'analyse des données recueillies par l'IMO, obtenues par 27 observateurs et portant sur 432 météores observés en 15 intervalles de temps, montre un ZHR maxi de 24, en supposant un index de population de r = 2.5. - en 2019 : L'analyse des données recueillies par l'IMO, obtenues par 24 observateurs et portant sur 95 météores observés en 14 intervalles de temps, montre un ZHR maxi de 28,9, en supposant un index de population de r = 2.5.
- en 2020 : L'analyse des données recueillies par l'IMO, obtenues par 51 observateurs et portant sur 248 météores observés en 18 intervalles de temps, montre un ZHR maxi de 20,56, en supposant un index de population de r = 2.5.
- en 2021 : L'analyse des données recueillies par l'IMO, obtenues par 9 observateurs et portant sur 76 météores observés en 13 intervalles de temps, montre un ZHR maxi de 12,33, en supposant un index de population de r = 2.5.
- en 2022 : L'analyse des données recueillies par l'IMO, obtenues par 20 observateurs et portant sur 582 météores observés, montre un ZHR maxi de 13,07, en supposant un index de population de r = 2.5.
|
||||||||
L'Avenir
Les "tempêtes" exceptionnelles auxquelles nous avons assisté au cours de ces dernières années font suite au dernier passage au périhélie de 55P/Tempel-Tuttle de Février 1998. Compte tenu du prochain passage de comète à proximité du Soleil prévu pour 2031, les années suivantes devraient en toute logique nous permettre d'assister à des pluies importantes de météores.
Selon les prévisions actuelles, les années 2033, puis 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2043, ou encore 2069 et 2077 devraient se révéler intéressantes au niveau de l'activité de l'essaim.
|
||||||||
L'observation des essaims de météores peut s'apprécier sans matériel spécifique, l'observation à l'oeil nu étant le moyen le plus simple de profiter du spectacle. Toutefois, pour ménager vos vertèbres cervicales, il est préférable de s'allonger à même le sol, d'utiliser une chaise longue ou un siège réglable, ce qui vous permettra ainsi de scruter le ciel dans de meilleures conditions.
Un carnet vous sera également indispensable si vous souhaitez noter vos observations, surtout si vous avez la chance de voir passer un bolide. Enfin, une paire de jumelles sera utile si vous souhaitez observer les traînées lumineuses laissées par les bolides.
Une manière efficace d'observer visuellement les météores est la méthode du comptage, où l'observateur note les météores vus sur un papier ou enregistre le comptage sur un magnétophone en donnant la magnitude estimée du météore et l'appartenance à l'essaim observé. Cette méthode très simple à mettre en oeuvre permet d'établir par la suite un rapport d'observation.
exemple : August 8, 2007 Lieu d'observation (Ville, Pays) Longitude 000 degrees 00' 00" East, Latitude 00 degrees 00' 00" North. UT Period Field Teff F LM PER KCG SPO 7:44-8:47 60N 1.01 1.0 6.51 3 2 9 Note : La première colonne (UT Period) fait référence à la période d'observation, en Temps Universel. Le seconde colonne (Field) est le secteur du ciel où le champ visuel a été concentré. La troisième colonne (Teff) représente le temps effectif d'observation, c'est-à-dire en tenant compte des pauses ou du temps non passé à observer le ciel. La colonne (LM) est la magnitude limite moyenne à l'oeil nu, déterminée à partir d'au moins trois champs d'étoiles. Les colonnes suivantes indiquent le nombre de météores pour chaque essaim observé.
Total Meteors: 14 Magnitude Distributions: Shower -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 PER 1 1 1 KCG 1 3 SPO 1 1 2 4
Note : La magnitude -4 est comparable à l'éclat
de la planète Vénus, la magnitude -1 à la brillante
étoile Sirius, La majorité des étoiles visibles
à l'oeil nu sont de magnitude +2 à +3. Les plus faibles
étoiles que l'on peut voir à l'oeil nu sous un ciel
bien sombre sont de magnitude +6 à +7. La table contient les magnitudes de tous les météores observés, et la moyenne (dernière colonne) pour l'essaim.
L'oeil nu peut détecter des météores jusqu'à approximativement la magnitude +7 dans d'excellentes conditions à proximité du centre du champ visuel. Les techniques vidéo permettent la détection des météores à la magnitude +8, et les observations de météores par radar ou avec un télescope peuvent permettre la détection de météores faibles, jusqu'à la magnitude +11. Si la détection au moyen de la photographie peut difficilement concurrencer ces deux dernières méthodes de recherche de météores qui réclament d'avantage de technique, elle est en revanche moins onéreuse et en conséquence plus facilement abordable pour l'astronome amateur.
L'observation vidéo a quelques avantages par rapport à d'autres méthodes d'observation, et peut être combinée avec l'observation visuelle, photographique ou télescopique. En utilisant un système vidéo vous avez la puissance d'un observateur visuel ou même télescopique, mais une exactitude beaucoup plus élevée. Vous pouvez déterminer tous les paramètres importants des météores tels que l'heure, le temps d'observation, la position, l'éclat, et la vitesse.
Les météores peuvent également être détectés par radio. En pénétrant dans l'atmosphère terrestre, le météore crée derrière lui une ionisation locale, qui à la propriété de réfléchir les ondes électromagnétiques du spectre radio. Le moyen le plus simple "d'entendre" cet écho radio est de rechercher une fréquence de la bande FM (88-108MHz) où habituellement aucune radio ne diffuse. Le passage d'un météore engendrera la diffusion d'un signal radio sporadique là où il n'y avait qu'un bruit de fond. Cependant, la majorité des échos sont très difficilement discernables car très rapides et presque noyés dans le bruit de fond. Des techniques un peu plus sophistiquées peuvent être mises en oeuvre au moyen d'une radio, d'un ordinateur, et d'un logiciel de détection, par toute personne intéressée par cette technique simple de radioastronomie.
L'International Meteor Organization (IMO) peut recevoir vos rapports d'observations si toutefois ceux-ci sont établis selon leurs directives. Les observateurs désirant envoyer leur rapport à l'IMO peuvent consulter les pages indiquant la procédure à suivre et les renseignements indispensables dont l'IMO a besoin pour la prise en compte des données : https://fireballs.imo.net/members/imo/report_intro
Rien de plus facile ! Un appareil photo (type reflex) muni d'un objectif grand-angle ouvert à f/d 2 réglé sur l'infini, un bon trépied stable et un déclencheur manuel pour éviter les vibrations. De bons résultats peuvent également être obtenus avec un 50mm ouvert au maximum.
Choisissez de préférence un film rapide de 400 ou 800 ISO.
Quelle que soit la position du radiant, visez de préférence au zénith, vous aurez ainsi plus de chance de capturer le passage d'étoiles filantes.
N'hésitez pas à faire des poses d'environ 3 à 5 minutes avec une pellicule 400 ISO, surtout si vous êtes loin de toutes lumières parasites. Evitez cependant d'avoir la Lune dans le champ de l'objectif, ou à proximité en raison des reflets secondaires. Si vous souhaitez privilégier la prise de vue des traînées persistantes, utilisez de préférence une pellicule de 800 ISO, avec un temps de pose compris entre 30 et 60 secondes.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||